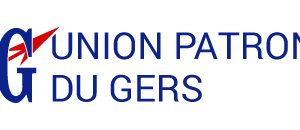Les informations sociales ayant retenues notre attention en ce mois d’octobre 2025
TELE TRAVAIL ET TITRES-RESTAURANT
Jusqu’au 8 Octobre 2025, des divergences existaient entre les juges du fond quant au bénéficie des titres-restaurant pour les télétravailleurs.
La Cour de Cassation dans un premier arrêt, a mis fin à compter de cette date à cette divergence en confirmant un jugement prud’homal qui avait jugé que l’employeur ne pouvait pas refuser des titres-restaurant au seul motif du télétravail.
Elle se fonde pour ce faire sur 3 articles du code du travail à savoir les articles :
- L.1222-9 qui reconnait au salarié télétravailleur les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
- L.3262-1 qui énonce que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie du prix du repas consommé au restaurant ou acheté…
- L’article R 3262-7 qui rappelle qu’un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier.
Dans un second arrêt la Cour de Cassation laisse cependant entendre qu’il est possible d’exclure des salariés du bénéfice des titres-restaurant à la condition que le principe d’égalité soit respecté.
FORFAIT JOURS
Fidèle à sa ligne protectrice concernant les salariés en forfait jours, la Cour de Cassation vient de sanctionner des accords collectifs autorisant la conclusion de forfait jours dont les garanties conventionnelles étaient insuffisantes au regard de la protection et de la santé des salariés.
La position de la Cour de Cassation doit amener les employeurs à s’interroger sur la conformité de leurs mesures conventionnelles et de modifier ou de renforcer les modalités des conventions de forfait, car sans une action de leur part, ils s’exposent à un contentieux qui leur sera défavorable.
A titre d’exemples, la Cour de Cassation ne sanctionne pas les dispositions d’un accord qui prévoient :
- un suivi des jours travaillés et de repos ainsi que de la charge de travail à l’aide d’un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
- un entretien proposé par la hiérarchie lorsque le document mensuel de décompte présente des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail et ayant pour objectif d’examiner des mesures correctives.
- un entretien supplémentaire possible à tout moment à l’initiative du salarié.
- un bilan effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
RETRAITE PROGRESSIVE : LE REFUS EVENTUEL DE L’EMPLOYEUR DOIT ETRE DAVANTAGE MOTIVE DEPUIS LA LOI DU 24 OCTOBRE 2025
Lorsque l’employeur souhaite refuser la demande du salarié à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive, il doit adresser son refus par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 mois et justifier depuis le lendemain de la publication de la loi du 24 octobre 2025 de son refus par « l’incompatibilité de la durée de travail souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.
L’indemnité de départ à la retraite peut être versée par anticipation au salarié pour financer la réduction du temps de travail.
L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PEUT ETRE VERSEE PAR ANTICIPATION AU SALARIE POUR FINANCER LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail en fin de carrière peuvent demander d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de leur rémunération.
Ce dispositif ne peut être mis en place que par accord collectif d’entreprise ou, par un accord de branche et le salarié doit demander l’accord de son employeur. L’accord collectif devra préciser les modalités de versement de l’indemnité de départ à la retraite avant la rupture du contrat ainsi que les modalités du versement du reliquat éventuel de l’indemnité au moment de son départ à la retraite.
VIDEOSURVEILLANCE DES SALARIES
Par délibération du 18 Septembre 2025, la CNIL a infligé une amende de 100 000 euros à un grand magasin parisien pour avoir dissimulé des caméras dans ses réserves au mépris des principes édictés par le RGPD.
La CNIL a plusieurs fois rappelé que pour pourvoir être exceptionnellement autorisé, l’usage de caméras de surveillance non visibles, doit obéir à de très strictes conditions : juste équilibre entre l’objectif poursuivi et la protection de la vie privée des salariés, conversations relevant de la sphère personnelle entre salariés ne devant pas être enregistrées, données personnelles recueillies ne pouvant pas être conservées de manière indéfinie, obligation de notifier à la CNIL la violation de données à caractère personnel…